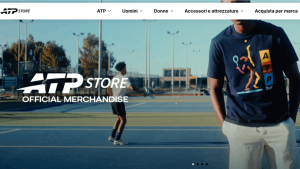Medjedovic balance tout : l’humidité de Shanghai transforme le Masters en cauchemar !

Des conditions de jeu extrêmes à Shanghai
Alors que se dispute le Masters 1000 de Shanghai, joueurs et spectateurs s’accordent pour qualifier les installations de « intolérables ». Avec une humidité relative qui flirte — voire dépasse — les 86 %, les courts couverts sont devenus de véritables hammams, où l’effort se double d’une lutte contre la chaleur et la moiteur ambiante.
Plusieurs éléments aggravent cette situation :
- La présence de toits fermés, indispensables pour préserver la qualité de jeu en cas de pluie, mais qui piègent la chaleur et limitent drastiquement la ventilation.
- L’enchaînement rapide des matchs : entre séances de balles, entraînements et rencontres officielles, les joueurs disposent de créneaux de récupération trop réduits pour compenser la fatigue accumulée.
- Le climat subtropical de Shanghai en octobre, où l’air saturé d’humidité nuit à l’évaporation de la sueur et freine le refroidissement naturel du corps.
Des manifestations inquiétantes sur le court
Au cours de ces premières journées, plusieurs tennistes ont dû abandonner leurs rencontres, non en raison d’une blessure proprement dite, mais à cause de malaises sérieux. Parmi eux :
- Terence Atmane, forcé de quitter le terrain après avoir subi des vertiges, malgré son excellente condition physique.
- Marton Fucsovics, victime d’une déshydratation aiguë qui l’a contraint à interrompre son match au terme d’un set âprement disputé.
- Hamad Medjedovic, contraint à l’abandon dès la 40e minute de son duel contre Arthur Rinderknech, sans signe avant-coureur de fatigue excessive.
Ces épisodes ont déclenché une vague d’indignation parmi les joueurs. Si les arrêts de jeu pour chaleur extrême existent depuis longtemps dans les tournois en plein air, on ne les attendait pas sous un toit fermé, censé protéger des aléas météo, pas transformer le court en une étuve.
Le jeune Medjedovic tire la sonnette d’alarme
En plein medical time-out face à Rinderknech, Hamad Medjedovic n’a pas mâché ses mots : « Comment peut-on nous laisser jouer dans ces conditions ? Sous ce toit, il n’y a pas d’air, il n’y a tout simplement pas d’air ! » Ces phrases, prononcées entre deux soins, illustrent l’urgence du problème.
Avec ses 22 ans et une endurance déjà reconnue, le Serbe a frappé les esprits. À 86 % d’humidité et une température ressentie proche de 32 °C, le corps peine à dissiper l’excès de chaleur. La sueur stagne sur la peau, la fréquence cardiaque s’emballe, et le risque de malaise s’intensifie.
Technique et physiologie se rejoignent pour expliquer cette détresse : la densité de l’air chargé d’humidité réduit l’échange gazeux alvéolaire, rendant chaque point plus épuisant. Les classiques stratégies de respiration en diaphragmatique s’avèrent insuffisantes, même pour les meilleurs athlètes.
Les impacts sur le jeu et la stratégie
Dans un tel environnement, le jeu se transforme :
- Les trajectoires de balle perdent en mordant : l’air plus dense freine la course du projectile, nécessitant une réadaptation rapide des frappes.
- La glisse sur le court devient moins prévisible : la surface humide accroît l’adhérence, augmentant les risques de faux-pas et de tensions musculaires.
- La gestion des échanges longs se corse : chaque point s’apparente davantage à un combat d’endurance qu’à un duel tactique.
Au final, les joueuses et joueurs contraints d’abandonner ne sont pas moins entraînés, mais le contexte transforme l’effort sportif en véritable défi physiologique.
Préserver la santé : pistes d’amélioration
Pour apporter des solutions, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
- Optimiser la ventilation : installer des extracteurs d’air ou des ventilateurs puissants permettrait de renouveler l’air sous les toits tout en contrôlant la température.
- Alléger le calendrier : espacer davantage les rencontres, instaurer des fenêtres de récupération obligatoires, ou limiter la durée des séances d’entraînement sur site.
- Équiper les joueurs : encourager le port de gilets de refroidissement durant les pauses, et multiplier les stations de brumisation pour lutter contre la déshydratation.
- Renforcer la surveillance médicale : multiplier les points de contrôle de la température corporelle et de la fréquence cardiaque, afin de détecter plus tôt les signes de coup de chaleur.
En tant qu’ancien -2/6, j’ai souvent ressenti la différence entre jouer sous un soleil caniculaire et dans une salle correctement climatisée. Les Masters 1000 de Shanghai exigent un format d’excellence, mais pas au détriment de la santé des athlètes. Un équilibre doit être trouvé entre exigences commerciales, cadre logistique et respect du corps humain.
Le rôle des instances et des joueurs
Les organisateurs, en lien avec l’ATP, doivent impérativement revoir l’aménagement des courts. Le Player Council peut à nouveau faire entendre la voix des joueurs, comme il l’a fait autrefois sur d’autres sujets sensibles. Les champions, par leur notoriété, ont un poids considérable pour impulser le changement.
Sur le court, chaque match doit rester un duel sportif, pas une épreuve d’endurance extrême. Les retours d’expérience des joueurs comme Medjedovic doivent servir de déclencheur : ignorer ces alertes, c’est risquer la santé de ceux qui font vivre le tennis.
Au-delà de Shanghai, c’est peut-être une remise à plat globale du circuit qui s’ouvre. L’engagement collectif des compétiteurs et des organisateurs sera déterminant pour préserver l’équilibre entre compétition de haut niveau et intégrité physique des athlètes.